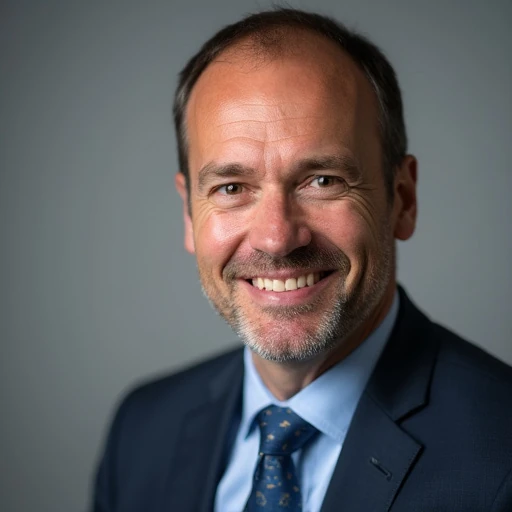Les barreaux de Nice et de Grasse ont annoncé la suspension des consultations juridiques gratuites à partir du 1er novembre. Cette action est une réponse directe à un projet de décret qui, selon eux, menace l'accès à la justice pour de nombreux citoyens en limitant sévèrement le droit de faire appel des décisions de première instance.
Les bâtonniers Emmanuel Brancaleoni et Franck Gambini, représentant respectivement les avocats de Nice et de Grasse, dénoncent une mesure qui risque de pénaliser les justiciables les plus modestes et de surcharger un système judiciaire déjà sous tension.
Les points clés de la contestation
- Le projet de décret propose de faire passer le seuil pour faire appel en matière civile de 5 000 € à 10 000 €.
- Il prévoit la suppression totale du droit d'appel pour certains litiges, comme les pensions alimentaires.
- Un "filtrage" des appels par le président de la Cour est également envisagé, limitant encore l'accès à un second jugement.
- Les avocats des Alpes-Maritimes suspendent leurs consultations gratuites pour protester contre cette réforme.
Un projet de réforme qui divise
Le ministère de la Justice a récemment transmis aux instances professionnelles un projet de décret, baptisé "Rivage", visant à "rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience". L'objectif affiché est de réduire les délais de traitement dans les cours d'appel, qui sont actuellement confrontées à un engorgement important.
Cependant, pour les avocats, cette approche est une fausse solution qui s'attaque aux conséquences plutôt qu'aux causes du problème. Ils estiment que limiter l'accès à l'appel n'est pas la bonne méthode pour améliorer l'efficacité de la justice.
La fin de l'appel pour les "petits litiges"
La mesure la plus controversée est le rehaussement du seuil financier, appelé "taux de dernier ressort", pour pouvoir faire appel d'une décision de justice en matière civile. Actuellement fixé à 5 000 €, ce seuil passerait à 10 000 €.
Concrètement, cela signifie que pour tout litige dont la valeur est inférieure à ce montant, la décision du premier juge serait définitive, sans possibilité de la contester devant une cour d'appel. Franck Gambini, bâtonnier de Grasse, s'inquiète des conséquences : "C'est la justice des petites gens qui va être malmenée", prévient-il, soulignant que de nombreux conflits du quotidien (litiges de consommation, problèmes de voisinage, petites créances) seraient ainsi privés d'un second regard judiciaire.
Le double degré de juridiction en question
Le droit de faire appel est un principe fondamental du système judiciaire français. Il garantit que toute affaire peut être jugée une seconde fois par une juridiction supérieure, la cour d'appel, afin de corriger d'éventuelles erreurs de droit ou d'appréciation des faits. Ce projet de réforme remet en cause ce principe pour une large catégorie de litiges.
Des contentieux familiaux exclus de l'appel
Le projet "Rivage" va plus loin en proposant de supprimer purement et simplement le droit de faire appel pour certaines matières, indépendamment de tout enjeu financier. Cette suppression concernerait des domaines particulièrement sensibles de la vie quotidienne.
"Le projet prévoit la suppression de l'appel dans des contentieux comme les pensions alimentaires, la contribution aux charges du mariage, ou encore les délais de paiement accordés par un juge", énumère le bâtonnier Franck Gambini.
Cette disposition suscite une vive inquiétude, car elle toucherait des décisions ayant des conséquences directes et immédiates sur la vie des familles et des personnes en situation de précarité financière. L'impossibilité de contester une décision jugée inéquitable en matière de pension alimentaire, par exemple, pourrait placer des familles dans des situations très difficiles.
L'instauration d'un "filtrage" des dossiers
Une autre mesure phare du projet est la mise en place d'un mécanisme de filtrage des appels. Dès le début de la procédure, le président de la cour d'appel pourrait décider si un dossier est "manifestement irrecevable" ou non.
Pour Emmanuel Brancaleoni, bâtonnier de Nice, ce "filtrage à tous les étages" constitue une barrière supplémentaire à l'accès au juge. Si un appel est rejeté à ce stade, le seul recours possible serait un pourvoi en cassation.
Un recours complexe et coûteux
Le pourvoi en cassation n'est pas une troisième instance de jugement. La Cour de cassation ne réexamine pas les faits de l'affaire, mais vérifie uniquement si la loi a été correctement appliquée. De plus, cette procédure est longue, complexe et représente un coût particulièrement important pour le justiciable, ce qui la rend inaccessible pour beaucoup.
Les avocats dénoncent donc une double atteinte : une atteinte au droit d'accès à la justice, mais aussi "une atteinte considérable aux intérêts économiques des justiciables qui vont être dans l'impossibilité de faire rejuger leur litige", selon les termes des bâtonniers.
Une réponse à l'engorgement des tribunaux ?
La Chancellerie justifie ce projet par la nécessité de désengorger les cours d'appel. La situation est particulièrement critique dans la région. "Il y a 22 000 dossiers en attente à la cour d'appel d'Aix-en-Provence", rappelle Emmanuel Brancaleoni. Les délais de traitement s'en ressentent lourdement.
Franck Gambini donne un exemple frappant : "Il faut quatre ans pour obtenir un arrêt d'appel en matière prud'homale dans la région."
Si les avocats reconnaissent la réalité du problème, ils refusent la solution proposée. "On ne peut pas interdire l'appel pour désengorger les tribunaux !" s'insurgent-ils. Pour eux, la réponse se trouve dans l'allocation de moyens humains et matériels suffisants à la justice, et non dans la restriction des droits des citoyens.
La mobilisation s'organise
Face à ce qu'ils considèrent comme une attaque contre les droits fondamentaux des justiciables, les avocats ont décidé d'agir. Suivant un mouvement national, les barreaux de Nice et de Grasse ont annoncé une mesure symbolique mais forte : la suspension des désignations d'avocats pour les consultations gratuites organisées dans le cadre du Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD).
À compter du 1er novembre, les permanences juridiques gratuites ne seront plus assurées. "Le but est d'envoyer un signal fort aux juridictions, qui remontera au premier président de la Cour d'appel puis au ministre", expliquent les bâtonniers. Ils insistent sur le fait que cette action, bien que pénalisante à court terme, vise à défendre les intérêts à long terme de tous les citoyens, qui sont les premiers concernés par cette réforme.