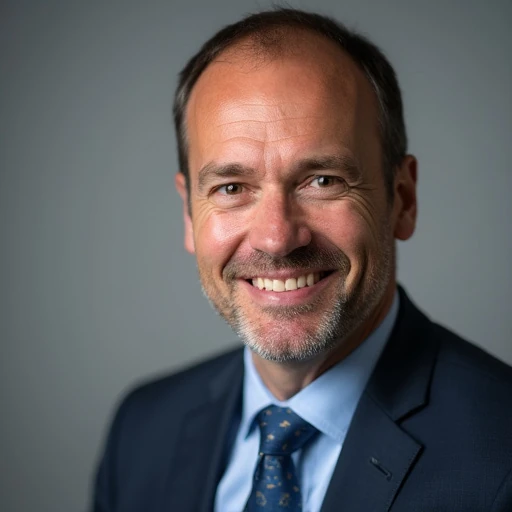Les sauveteurs bénévoles du Spéléo Secours Français 06 ont mené un exercice de sauvetage complexe dans une cavité souterraine à Malaussène, dans l'arrière-pays niçois. Cette simulation, organisée le 18 octobre, a permis de tester en conditions réelles les procédures d'intervention pour secourir un spéléologue blessé à 300 mètres de profondeur, mettant en lumière l'expertise technique des équipes mais aussi leurs difficultés financières.
L'opération a mobilisé plusieurs équipes spécialisées qui ont dû collaborer pour localiser, stabiliser et évacuer la victime dans un environnement particulièrement hostile, où la communication et la gestion de la température sont des défis constants.
Points Clés
- Un exercice de sauvetage spéléologique a été mené à Malaussène pour simuler l'évacuation d'un blessé.
- L'opération a testé la coordination entre un poste de commandement en surface et des équipes spécialisées sous terre.
- La gestion de l'hypothermie et la communication à travers la roche sont des défis majeurs dans ce type de secours.
- Le Spéléo Secours Français 06, composé de 92 bénévoles, fait face à un manque de financements publics pour son matériel.
Déploiement d'une opération de secours complexe
Le samedi 18 octobre 2025, à 7h30, une alerte a été déclenchée : un homme de 65 ans se serait blessé au genou dans une grotte près des gorges de la Mescla. Bien que fictive, cette alerte a enclenché une mobilisation complète des sauveteurs du Spéléo Secours Français 06 (SSF 06) dans des conditions très proches de la réalité.
La première étape a été l'installation d'un poste de commandement en surface. Ce centre névralgique est essentiel pour définir la stratégie d'intervention et coordonner les différentes équipes qui opèrent sous terre. Chaque groupe a une mission précise pour garantir l'efficacité du sauvetage.
La technologie au service de la communication
L'un des plus grands défis en milieu souterrain est la communication. L'équipe de transmission a déployé un système ingénieux pour surmonter cet obstacle. En utilisant des téléphones filaires et des dispositifs sans fil, ils ont établi une liaison entre la surface et les profondeurs de la grotte.
Ce système repose sur des électrodes placées contre la roche, à la fois en surface et sous terre, permettant aux ondes de traverser le massif calcaire. Les informations sont ensuite relayées par radio jusqu'au poste de commandement, assurant un flux de communication constant.
Le rôle du Spéléo Secours Français
Le Spéléo Secours Français (SSF) est une commission de la Fédération Française de Spéléologie. Il est chargé d'organiser et de conduire les opérations de sauvetage dans tous les milieux souterrains, qu'ils soient naturels ou artificiels. L'antenne des Alpes-Maritimes (SSF 06) compte 92 sauveteurs bénévoles hautement qualifiés.
La prise en charge de la victime : une course contre le froid
Une fois la communication établie, l'équipe d'assistance à la victime a pu intervenir. Leur priorité absolue sous terre n'est pas toujours la blessure elle-même, mais la lutte contre l'hypothermie. Le froid et l'humidité sont les principaux dangers pour une personne immobilisée.
Elia Borrello, cheffe de cette équipe, explique : « Le plus compliqué à gérer va être la température. On est dans des cavités où il y a un fort taux d’humidité. On se refroidit très vite. » Pour contrer ce phénomène, les sauveteurs ont installé un « point chaud », une sorte de tente isolante, et ont utilisé des couvertures de survie, des chaufferettes et des vêtements techniques.
« Après, c’est davantage une gestion de la douleur en attendant de ressortir en surface… Et la prise des constantes vitales qu’on transmet régulièrement au poste de commandement. » - Elia Borrello, cheffe d'équipe assistance victime
Parallèlement, l'équipe de gestion administrative, dirigée par Loïc Guillon, conseiller technique départemental adjoint, documente chaque action. Des mains courantes au suivi individuel de chaque sauveteur, tout est consigné pour assurer la sécurité et l'efficacité de l'opération.
L'évacuation : un défi physique et technique
L'étape finale et la plus spectaculaire est l'évacuation de la victime. C'est la mission de l'équipe d'évacuation, qui doit préparer le parcours pour permettre le passage de la civière. « Sa mission : équiper la cavité pour pouvoir évacuer la victime dans la civière », précise Christophe Duverneuil, conseiller technique départemental en spéléologie.
Cette phase se fait entièrement à la force des bras. Il faut franchir de nombreux obstacles tout en gardant la civière le plus à l'horizontale possible pour le confort et la sécurité du blessé.
Un parcours du combattant souterrain
Le milieu souterrain est un labyrinthe d'obstacles. Les sauveteurs doivent naviguer à travers des puits verticaux, des galeries étroites, des rivières souterraines et des boyaux étroits. Pour cela, ils utilisent des techniques variées comme les tyroliennes ou des systèmes de contrepoids pour hisser ou descendre la civière.
Chaque mouvement est un effort intense et calculé pour éviter tout suraccident, qui pourrait mettre en péril à la fois la victime et les sauveteurs eux-mêmes. L'exercice du jour a été mené à bien, démontrant une fois de plus le professionnalisme des équipes.
Un engagement bénévole face à des défis financiers
Le SSF 06 intervient en moyenne sur deux accidents de spéléologie par an dans les Alpes-Maritimes. Ses 92 membres sont tous des bénévoles passionnés. Comme le résume Christophe Duverneuil : « On est notre propre secours. » Cette autonomie, unique pour une fédération sportive, a cependant un revers.
L'association fait face à un manque criant de financements. Contrairement à d'autres départements de la région, elle ne reçoit aucune subvention du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), du conseil départemental ou des intercommunalités locales.
Cette situation oblige les bénévoles à financer eux-mêmes une partie du matériel indispensable à leurs missions. Les coûts sont pourtant élevés :
- Une civière de sauvetage coûte 2 500 euros et doit être remplacée tous les dix ans.
- Le budget pour le renouvellement des cordes s'élève à 4 000 euros tous les dix ans.
Ce manque de soutien public met en péril la pérennité de cette organisation essentielle à la sécurité des pratiquants d'activités souterraines dans la région, qui repose entièrement sur l'engagement et les fonds personnels de ses membres.