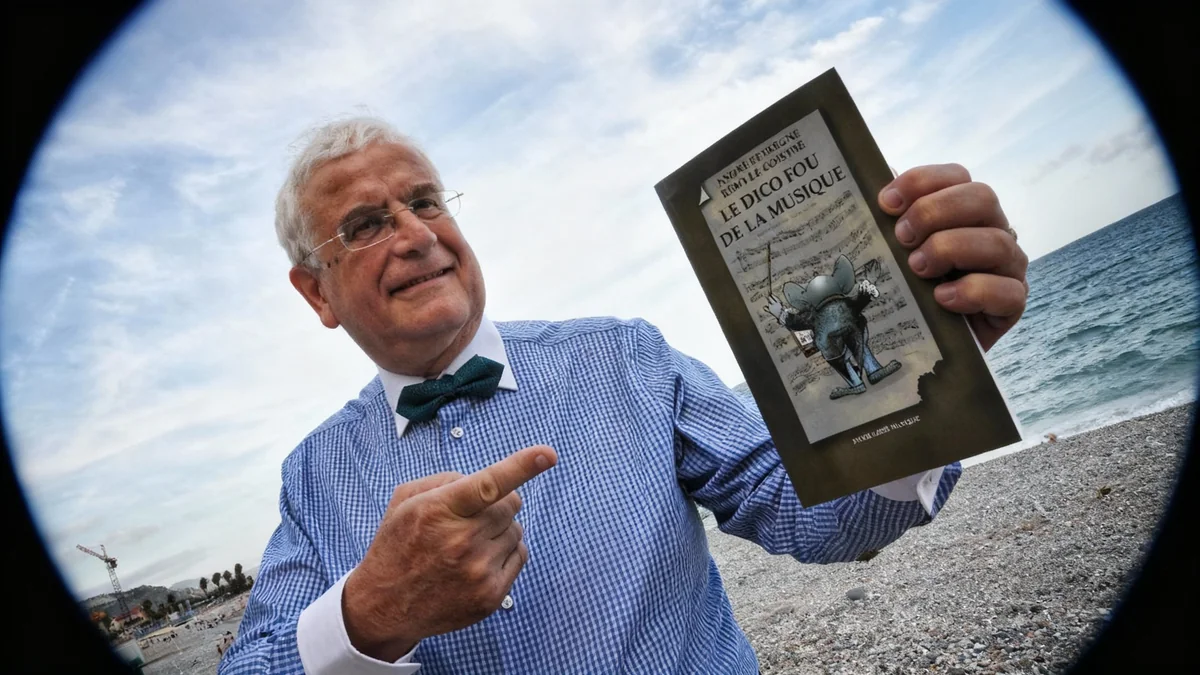À Nice, deux jeunes femmes, Jeanne et Chahinez, participent à un essai clinique pour un nouveau test de dépistage de l'endométriose. Après des années de douleurs intenses, d'errance médicale et d'incompréhension, elles espèrent enfin obtenir un diagnostic qui pourrait changer leur vie et valider leur souffrance.
Leurs témoignages poignants mettent en lumière les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes face à cette maladie complexe, dont les symptômes sont souvent minimisés ou mal interprétés, entraînant des conséquences dévastatrices sur leur vie personnelle et professionnelle.
Points Clés
- Deux jeunes femmes de la région niçoise, Jeanne (20 ans) et Chahinez (21 ans), participent à l'essai clinique Endobest au CHU de Nice.
- Elles souffrent depuis des années de douleurs invalidantes sans avoir obtenu de diagnostic clair pour l'endométriose.
- Leurs parcours illustrent le phénomène de l'errance diagnostique, marquée par des examens non concluants et une minimisation de leurs symptômes.
- L'absence de diagnostic officiel a des répercussions graves, notamment la perte d'emploi et l'isolement social.
- Le nouvel Endotest représente pour elles un espoir majeur : celui d'être enfin crues et de pouvoir accéder à une meilleure prise en charge.
L'attente d'un nom sur des années de souffrance
Au Centre de recherche clinique du CHU de Nice, l'atmosphère est chargée d'espoir. C'est ici que se déroule l'essai clinique Endobest, centré sur un nouveau test salivaire prometteur pour le diagnostic de l'endométriose. Pour des participantes comme Jeanne et Chahinez, ce test représente bien plus qu'une simple procédure médicale ; il incarne la fin potentielle d'un long et douloureux parcours.
L'endométriose est une maladie chronique qui touche environ 10 % des femmes en âge de procréer. Elle se caractérise par la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, provoquant des douleurs intenses et d'autres symptômes invalidants. Pourtant, le diagnostic prend en moyenne sept ans, une période d'incertitude que ces jeunes femmes connaissent trop bien.
Le cas de Jeanne, 20 ans : une douleur qui paralyse
Jeanne, originaire de Draguignan, est venue accompagnée de sa mère, Christine. À seulement 20 ans, sa vie est dictée par une douleur qu'elle évalue à 9 sur une échelle de 10. « Parfois, je n'arrive même plus à marcher », confie-t-elle. Les crises sont si intenses qu'elles l'ont conduite à utiliser des antalgiques puissants, allant jusqu'à l'Acupan administré par voie intraveineuse, un traitement généralement réservé au milieu hospitalier.
Sa mère, infirmière de profession, a rapidement compris que les troubles de sa fille dépassaient le cadre de simples douleurs menstruelles. « Ses douleurs au moment des règles sont atroces. On a consulté plusieurs gynécologues, mais personne n'arrive à en comprendre l'origine, d'autant que rien de particulier n'apparaît à l'imagerie », explique-t-elle.
Qu'est-ce que l'errance diagnostique ?
L'errance diagnostique désigne la longue période entre l'apparition des premiers symptômes d'une maladie et le moment où un diagnostic formel est posé. Pour l'endométriose, cette période est particulièrement longue, souvent due à la normalisation des douleurs menstruelles et à la difficulté de visualiser les lésions via les techniques d'imagerie standards comme l'échographie ou l'IRM.
Les conséquences au-delà de la douleur physique
La souffrance de Jeanne n'est pas seulement physique. Elle a des répercussions profondes sur tous les aspects de sa vie. Ses douleurs digestives chroniques, qui l'empêchent parfois de s'alimenter, ont fait chuter son poids à 40 kg. Mais c'est sur le plan professionnel que l'impact a été le plus brutal.
Employée dans un hôtel cinq étoiles, elle a été licenciée en raison de ses absences répétées. Les jours où elle parvenait à travailler malgré la douleur, on lui reprochait sa posture « trop contractée ». En tentant d'expliquer sa situation, elle s'est heurtée à un mur d'incompréhension, recevant des commentaires déplacés comme : « Faites-vous couper les ovaires ! »
« Faute de diagnostic officiel, elle ne peut pas bénéficier d'un aménagement de poste, ni d'une reconnaissance de handicap », regrette sa mère. Pour Jeanne, l'enjeu du test est clair : « Je veux juste comprendre pourquoi j'ai si mal. J'espère que ce test dira que c'est ça, une endométriose. »
Chahinez, 21 ans : se battre pour être crue
Le récit de Chahinez, une Niçoise de 21 ans, fait écho à celui de Jeanne. Pour elle, le calvaire a commencé dès ses premières règles, à l'adolescence. « D'emblée, c'était insupportable. Je pleurais à l'école, je faisais des hémorragies, je ne pouvais plus marcher », se souvient-elle. Pendant des années, elle a cru que sa douleur était normale, un message que la société renvoie souvent aux jeunes filles.
C'est une infirmière scolaire qui, la première, a prononcé le mot « endométriose » alors que Chahinez avait 15 ans. Mais les médecins consultés par la suite ont balayé cette hypothèse. « On me disait que j'étais trop jeune, que c'était un mot à la mode, que j'exagérais », raconte-t-elle. Ce sentiment de n'être pas crue est une blessure supplémentaire qui s'ajoute à la douleur physique.
L'endométriose en chiffres
- 1 femme sur 10 est touchée par l'endométriose dans le monde.
- 7 ans est le délai moyen pour obtenir un diagnostic en France.
- 40% des femmes atteintes d'endométriose souffrent de problèmes de fertilité.
- Les symptômes incluent des douleurs pelviennes, des troubles digestifs et urinaires, ainsi qu'une fatigue chronique.
Une lueur d'espoir grâce à un traitement, puis la rechute
À 18 ans, la vie de Chahinez a basculé lorsqu'elle a consulté le Professeur Jérôme Delotte au CHU de Nice. Un traitement hormonal lui a été prescrit, et les résultats ont été spectaculaires. « C'était le meilleur choix de ma vie. Je n'avais plus mes règles, plus les douleurs, même mes intolérances alimentaires ont disparu. C'était comme renaître », décrit-elle.
Malheureusement, cette période de répit a été de courte durée. Après un an, une migraine ophtalmique sévère, un effet secondaire du traitement, l'a contrainte à tout arrêter. Les symptômes sont revenus, encore plus forts qu'auparavant, notamment les troubles digestifs. Les examens d'imagerie, comme pour Jeanne, sont restés ambigus. Une IRM a bien détecté un petit endométriome, mais il a été jugé « sans importance ».
L'Endotest : une révolution pour le diagnostic ?
Face à ces impasses diagnostiques, l'Endotest représente une véritable révolution potentielle. Développé par une société française, ce test salivaire analyse des micro-ARN pour détecter la maladie avec une fiabilité annoncée de plus de 95 %. S'il tient ses promesses, il pourrait réduire drastiquement l'errance médicale et permettre une prise en charge plus rapide et adaptée.
Pour Chahinez, comme pour Jeanne, le résultat de ce test est crucial. Il ne s'agit pas de vouloir être malade, mais de pouvoir enfin mettre un mot sur leur mal et de faire reconnaître leur réalité. « Je voudrais que le test soit positif », avoue Chahinez. « Pas parce que je veux être malade, mais parce que je veux savoir. Et je veux qu'on me croie. » Un souhait simple mais fondamental, partagé par des milliers de femmes qui attendent, elles aussi, d'être entendues.