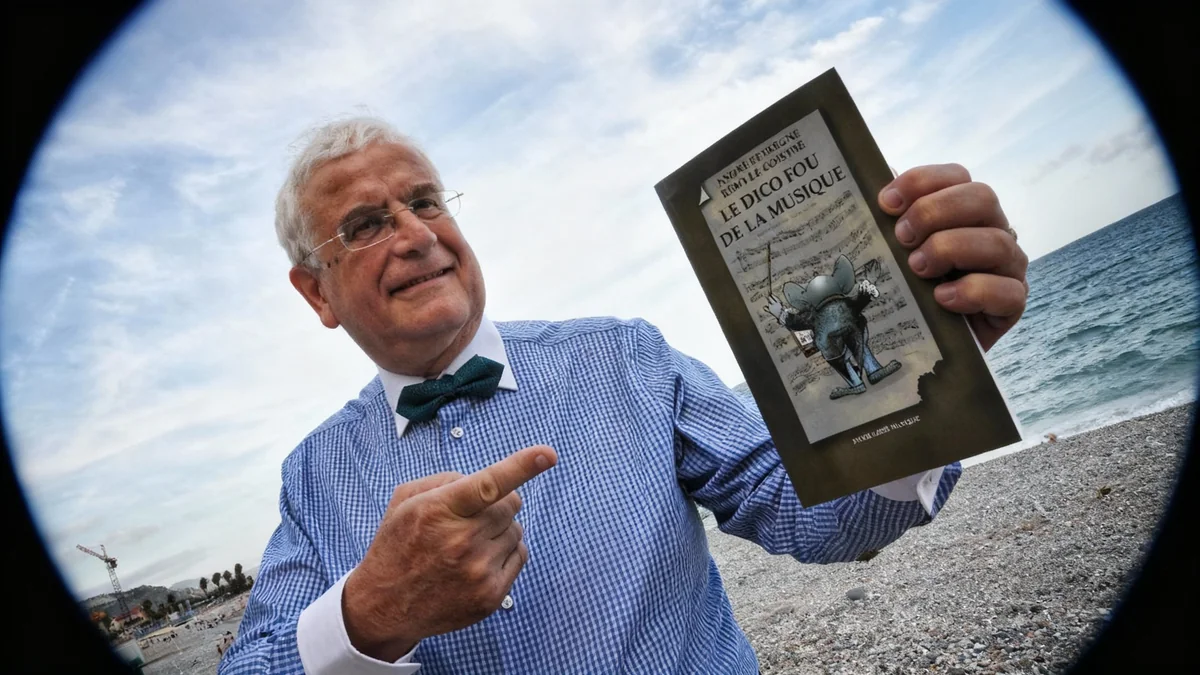La Faluche, une confrérie étudiante plus que centenaire, est bien connue dans le paysage universitaire niçois. Identifiables à leurs bérets de velours couverts d'insignes, ses membres perpétuent des traditions mêlant rites, chants et soirées festives. Cependant, un récent incident a contraint cette organisation à revoir certaines de ses pratiques les plus controversées, marquant un tournant dans son histoire locale.
Entre la nécessité de préserver un héritage et l'obligation de s'adapter aux nouvelles sensibilités, la Faluche de Nice navigue aujourd'hui en eaux troubles. Ses membres, principalement issus des filières de santé, cherchent un équilibre pour faire perdurer un esprit de camaraderie face à une réputation sulfureuse et une surveillance accrue de la part des autorités universitaires.
Points Clés
- La Faluche est une fraternité étudiante française créée en 1888, reconnaissable à son béret de velours.
- À Nice, un incident grave en janvier a entraîné l'interdiction des soirées alcoolisées par la faculté de médecine.
- Des rituels controversés, notamment des danses impliquant la nudité, ont été suspendus localement.
- La confrérie a dû changer de lieu de rassemblement et augmenter ses tarifs, modifiant l'ambiance de ses soirées.
- Malgré les changements, la Faluche continue d'attirer de jeunes étudiants en quête de camaraderie et de décompression.
Une tradition étudiante ancrée dans l'histoire
La Faluche n'est pas un simple folklore. C'est une tradition qui remonte à 1888, lorsque des étudiants français ont voulu se distinguer lors des 800 ans de l'université de Bologne. Ils ont alors créé cette coiffe en velours noir, devenue depuis le symbole d'une vie étudiante riche en codes et en histoire.
À Nice, comme ailleurs en France, la Faluche rassemble des étudiants de diverses filières, bien que les cursus de santé y soient surreprésentés. Pour ses membres, elle est bien plus qu'une simple association. "Nos études sont exigeantes, on a besoin de décompresser, de se soutenir", explique Eva*, une étudiante membre. "C’est juste de la camaraderie, il n’y a rien de scandaleux."
Le béret : une carte d'identité
La faluche elle-même est un véritable livre ouvert pour qui sait en déchiffrer les symboles. Chaque insigne, chaque couleur de ruban raconte une partie de la vie de son propriétaire : son parcours scolaire, sa filière (velours rouge pour la médecine), ses origines géographiques, et même des détails sur sa vie personnelle. "Un fin connaisseur pourra y lire toute la vie d’un frère ou d’une sœur. Ce n’est pas un déguisement", insiste Hugo*, un autre membre.
Les rassemblements hebdomadaires, appelés "Apéral", sont le cœur de la vie falucharde. C'est l'occasion pour les membres et les sympathisants de se retrouver, d'entonner des chants paillards et de partager un moment loin de la pression des cours.
Les rites d'initiation au cœur des fantasmes
Pour intégrer la Faluche, un étudiant doit passer par un rite d'initiation appelé la "déclaration". Cet événement alimente de nombreux fantasmes en raison de sa nature privée et de ses épreuves parfois déroutantes.
La cooptation et la préparation
Tout commence par une cooptation. Un postulant, ou "impétrant", doit être présenté par un parrain ou une marraine, qui a la charge de lui enseigner les bases de la tradition : les codes, les chants et la symbolique des insignes. Avant la déclaration publique, les plus anciens s'entretiennent avec le candidat pour évaluer ses connaissances.
"Nous sommes gardiens d’une tradition : symboles, chants et rites doivent être correctement transmis", affirme un initié.
Cette étape est prise au sérieux. Un candidat dont les connaissances sont jugées insuffisantes peut être recalé, démontrant que l'adhésion n'est pas automatique.
L'épreuve des questions
La déclaration se déroule ensuite devant l'ensemble des membres. Les candidats sont placés sur une estrade et soumis à une série de questions. Celles-ci sont souvent grivoises et intimes, testant la répartie et l'aisance des postulants. Par exemple, une question posée à une flûtiste pourrait être : "À qui souhaiterais-tu jouer un petit air ?" Chaque réponse est accueillie par les acclamations ou les taquineries de l'assemblée.
Pendant les déclarations, l'usage des téléphones est formellement interdit. Aucune photo ou vidéo n'est autorisée afin de préserver la confidentialité du rituel et d'éviter que des images ne soient diffusées hors du cercle des initiés.
Un tournant après un grave incident
Le folklore de la Faluche niçoise a été brutalement remis en question en janvier dernier. Un étudiant en deuxième année de médecine a été hospitalisé en réanimation à la suite d'un bizutage organisé non pas par la Faluche elle-même, mais par une association étudiante concurrente connue pour ses excès.
La réaction de l'université a été immédiate et sévère. La faculté de médecine a dissous l'association en cause et a prononcé une interdiction de toutes les soirées alcoolisées affiliées à l'UFR. Cette mesure a eu un effet direct sur les activités de la Faluche, qui a dû cesser ses événements festifs traditionnels.
La fin d'une ère au "Groovin'"
Jusqu'à cet événement, le point de ralliement des faluchards était le bar "Le Groovin'" dans le Vieux-Nice. Chaque lundi, la soirée "Apéral" y attirait la foule avec une offre attractive : six consommations pour dix euros. Mais une altercation a mis fin à ce partenariat, forçant le groupe à trouver un nouveau lieu.
Après un passage peu concluant dans un autre bar, les soirées ont repris à "L'Antre", un club techno. L'ambiance a changé : le tarif est passé à 15 euros pour quatre verres, et l'alcool, autrefois central, est devenu plus secondaire.
La suspension des rituels de nudité
Le changement le plus significatif concerne les rituels qui suivaient les déclarations. Le "Limousin" pour les hommes et "L'Auvergnat" pour les femmes étaient des danses durant lesquelles les participants se déshabillaient progressivement, parfois jusqu'à la nudité complète.
Depuis l'incident de janvier et la pression universitaire, ces pratiques ont été suspendues à Nice. Cette décision divise la communauté :
- Certains anciens estiment que la fête est "vidée de son âme", considérant cette danse comme une "preuve d'audace" et le "cœur du rite".
- D'autres, plus jeunes, expriment un soulagement. "Ma copine n'était pas trop chaude à l'idée que je me foute à poil", confie un membre récent. "C'est pas plus mal si cette danse ne se fait plus."
Cette pratique flirtait avec les limites du consentement, car une forte pression de groupe s'exerçait sur les participants. La suspension est présentée comme temporaire, "le temps qu'on nous oublie", suggère un membre, mais elle marque une évolution profonde des mœurs au sein de la fraternité.
Quel avenir pour la Faluche à Nice ?
Aujourd'hui, la Faluche niçoise fait face à un double défi : un renouvellement générationnel et une image à redorer. La moyenne d'âge des participants aux soirées a baissé, tournant autour de 20-21 ans, tandis que les membres plus anciens se font plus rares.
Malgré les turbulences, la tradition perdure. Elle continue d'offrir un espace de sociabilité et de soutien pour des étudiants soumis à une forte pression académique. La Faluche a survécu à des guerres mondiales et à de multiples changements sociétaux. Son histoire à Nice prouve sa capacité d'adaptation, même si celle-ci est aujourd'hui dictée par des contraintes extérieures.
Cette confrérie, avec ses mystères et ses controverses, reste un élément marquant de la vie étudiante. Le fait qu'un professeur de médecine renommé expose encore fièrement sa faluche dans son cabinet témoigne de l'attachement que ses membres lui portent, bien après la fin de leurs études.
* Tous les prénoms ont été modifiés pour garantir l'anonymat des personnes interrogées, le reportage ayant été réalisé de manière non officielle.