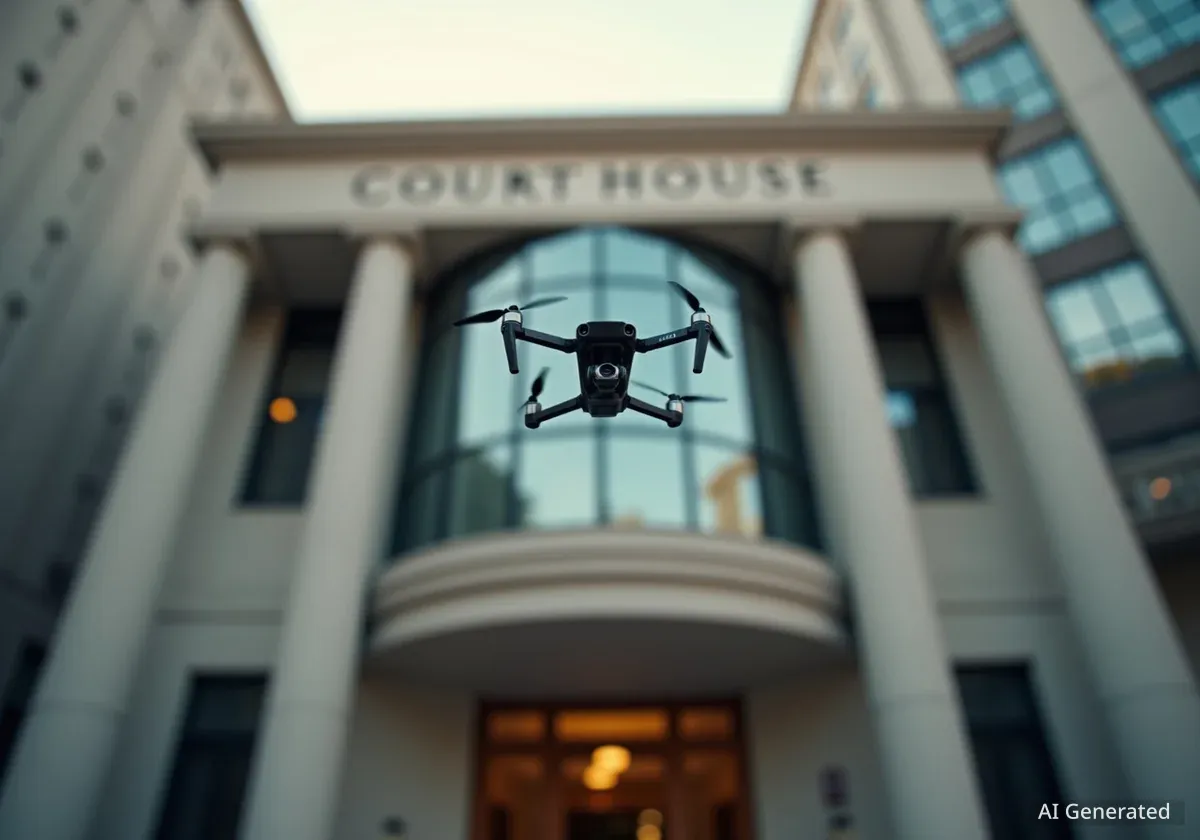Le tribunal administratif de Nice a récemment annulé un arrêté préfectoral datant de décembre 2023 qui autorisait la surveillance par drones de dix communes des Alpes-Maritimes durant les fêtes de fin d'année. La justice a jugé cette mesure « disproportionnée », marquant une victoire pour les associations de défense des libertés publiques qui contestaient cette pratique.
Cette décision, bien que portant sur une mesure qui n'est plus en vigueur, soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre sécurité et respect de la vie privée, alors que l'usage de cette technologie de surveillance se généralise dans le département.
Points Clés
- Le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté préfectoral du 18 décembre 2023.
- L'arrêté autorisait la gendarmerie à utiliser des drones de surveillance dans dix communes des Alpes-Maritimes.
- La justice a qualifié le recours à cette technologie de « disproportionné » dans ce contexte.
- La contestation a été menée par la Ligue des droits de l'homme (LDH) et l'association Adelico.
Contexte de l'arrêté contesté de fin 2023
Le 18 décembre 2023, la préfecture des Alpes-Maritimes avait pris un arrêté autorisant les forces de gendarmerie à déployer des drones pour surveiller les espaces publics. Cette mesure visait à renforcer la sécurité durant la période des fêtes de fin d'année, une période souvent marquée par une forte affluence.
Dix communes du département étaient spécifiquement concernées par cette autorisation de surveillance aérienne. Il s'agissait de Drap, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade. Ensemble, ces municipalités représentent une part significative de la population du département.
Un périmètre de surveillance étendu
Les dix communes visées par l'arrêté de 2023 regroupaient près de 10 % de la population totale des Alpes-Maritimes. Cette large portée a été l'un des arguments soulevés par les associations pour dénoncer une surveillance généralisée plutôt qu'une mesure ciblée.
L'objectif affiché par les autorités était de prévenir les troubles à l'ordre public, les infractions et de sécuriser les rassemblements. Cependant, le caractère général de la mesure a rapidement suscité des inquiétudes parmi les défenseurs des libertés individuelles.
La mobilisation des associations pour les libertés publiques
Dès le lendemain de la publication de l'arrêté, la section locale de la Ligue des droits de l'homme (LDH), accompagnée par l'association Adelico, a décidé de contester cette mesure devant la justice. Ces organisations ont estimé que l'utilisation de drones pour une surveillance généralisée portait une atteinte grave aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée.
Une première requête en référé, visant à suspendre l'application de l'arrêté en urgence, avait été rejetée. Malgré ce premier revers et le fait que l'arrêté n'avait qu'une durée de vie limitée, les associations ont maintenu leur action sur le fond. Leur démarche visait à obtenir une décision de principe sur la légalité de ce type de surveillance.
« Il y a une banalisation de cet outil que le conseil constitutionnel a pourtant lui-même qualifié de particulièrement intrusif », a déclaré Henri Busquet, représentant local de la LDH, pour expliquer la persévérance de l'association.
Même si la préfecture avait abrogé son propre arrêté avant son terme et ne l'avait pas renouvelé les années suivantes, le combat juridique s'est poursuivi. L'enjeu pour les plaignants était de faire reconnaître le caractère potentiellement excessif de ces dispositifs de sécurité.
Une victoire judiciaire fondée sur le principe de proportionnalité
Près de deux ans après les faits, le tribunal administratif de Nice a finalement rendu sa décision sur le fond de l'affaire. Les juges ont donné raison aux associations en annulant l'arrêté préfectoral de décembre 2023. La principale raison invoquée est que le recours aux drones était « disproportionné » par rapport aux objectifs de sécurité affichés.
La justice administrative contrôle en effet que les mesures de police qui restreignent les libertés sont nécessaires, adaptées et proportionnées à la menace. Dans ce cas précis, le tribunal a estimé que la préfecture n'avait pas suffisamment démontré la nécessité d'une surveillance aussi large et intrusive pour garantir la sécurité pendant les fêtes.
Une tendance à la généralisation de la surveillance
Selon le décompte effectué par la LDH, plus d'une centaine d'arrêtés autorisant l'usage de drones de surveillance ont été pris dans les Alpes-Maritimes depuis mars 2023. Ces autorisations concernent régulièrement des manifestations à Nice ou des événements majeurs à Cannes, illustrant une utilisation de plus en plus systématique de cette technologie.
Cette décision de justice pourrait donc faire jurisprudence et obliger les autorités à mieux justifier le recours à la surveillance par drones à l'avenir. Elle rappelle que les impératifs de sécurité doivent toujours être mis en balance avec le respect des droits fondamentaux des citoyens.
Les implications pour l'avenir de la surveillance par drone
Si la décision du tribunal administratif de Nice ne concerne qu'un arrêté passé, elle envoie un signal fort aux autorités. Elle souligne que l'utilisation de technologies de surveillance, même pour des motifs de sécurité publique, doit être strictement encadrée et justifiée.
Henri Busquet, pour la LDH, précise ne pas contester l'utilité des drones dans des cas très spécifiques, comme « pour suivre par exemple un délinquant notoire ». Ce qui est remis en cause, c'est bien « la systématisation de leur usage » pour une surveillance de masse de la population.
Ce jugement intervient dans un contexte de débat national et européen sur l'encadrement des nouvelles technologies de surveillance, incluant la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle. La décision de Nice vient renforcer la position de ceux qui appellent à une plus grande vigilance pour protéger les libertés publiques face aux innovations technologiques sécuritaires.